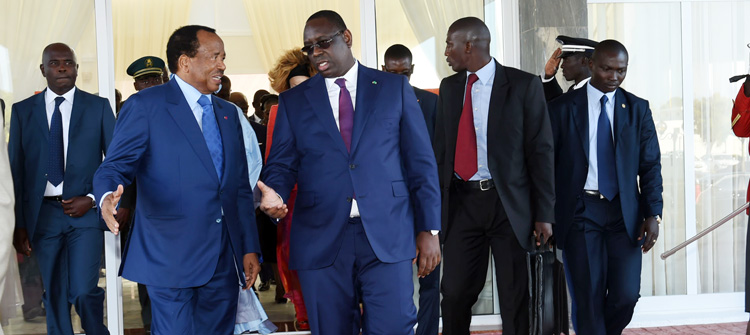La régulation électorale occupe une place cruciale dans la stabilité politique du Cameroun, particulièrement à l’approche d’échéances aussi sensibles que la présidentielle de 2025. L’institution en charge, Elections Cameroon (ELECAM), se retrouve aujourd’hui au centre d’une tempête médiatique et politique, accusée par de nombreux observateurs nationaux et internationaux de partialité et d’opacité dans la gestion du processus électoral. Cette mise en cause cristallise une interrogation majeure : ELECAM est-elle en mesure d’assurer une compétition électorale véritablement équitable et transparente ?
Une composition controversée, source de défiance
Depuis sa création, ELECAM suscite la méfiance. Beaucoup d’acteurs politiques dénoncent la proximité de ses membres avec le pouvoir central, alimentant le soupçon d’une institution plus soucieuse de préserver les intérêts du régime en place que de garantir la neutralité du processus électoral. À chaque élection, les voix se multiplient pour exiger une réforme de la composition de cet organe afin de renforcer son indépendance réelle, non seulement sur le papier mais dans la pratique.
Sélection des candidatures : opacité ou rigueur ?
La gestion récente des dossiers de candidature à la présidentielle 2025 exemplifie ces tensions. Plusieurs figures de premier plan de l’opposition, dont Maurice Kamto, se sont vu refuser l’accès au scrutin, officiellement sur la base de critères strictement juridiques. Toutefois, le manque criant de transparence sur les modalités d’analyse des dossiers, l’absence de publication claire des décisions motivées et le refus de communiquer certains éléments à la presse et à la société civile renforcent le sentiment d’arbitraire. Des ONG, telles que Transparency International ou le Réseau Africain pour la Démocratie, ont publiquement appelé à plus de rigueur, estimant que l’opacité actuelle nuit gravement à la crédibilité du processus.
Le rôle des observateurs internationaux
En réponse à ces critiques, ELECAM affirme respecter scrupuleusement le cadre légal, et met en avant l’observation électorale internationale comme gage de transparence. Mais beaucoup déplorent que les missions d’observation soient souvent réduites à un rôle de figuration, sans accès direct aux étapes clés du filtrage des candidatures ni possibilité de suivre le traitement en temps réel des recours. L’Union africaine et plusieurs ambassades occidentales ont relevé ces limites, exhortant le Cameroun à renforcer ses garanties institutionnelles.

Un défi pour la stabilité future du pays
La confiance dans l’impartialité d’ELECAM n’est pas un détail technique : c’est un prérequis pour prévenir tout incident ou contestation majeure à l’annonce des résultats. Dans une région troublée par les crises post-électorales, du Gabon à la République centrafricaine, le Cameroun joue gros en matière de réputation internationale mais aussi de paix civile intérieure. Un échec de l’organe électoral pourrait ouvrir la voie à des mobilisations massives et à des formes de désobéissance civile difficilement contrôlables.
Vers une réforme : quelles pistes ?
Des voix plaident pour une recomposition paritaire d’ELECAM, associant majorité, opposition, société civile et personnalités reconnues pour leur intégrité. Une telle évolution demeure cependant improbable avant le scrutin à venir, les autorités estimant que le dispositif actuel offre toutes les garanties nécessaires. Reste à savoir si cette posture permettra de préserver l’indispensable sérénité du processus électoral.